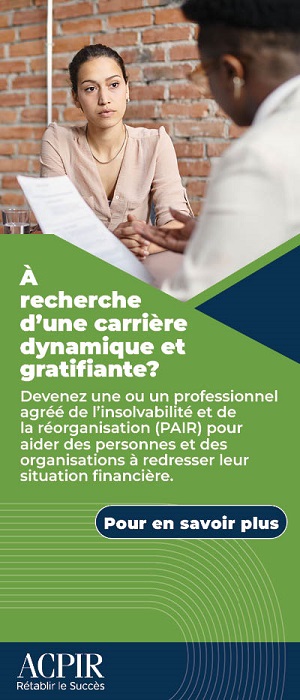Articles de fond de la revue Rebuilding Success - Printemps/Été 2025 > Au carrefour de la fraude et de la bonne foi en matière d’insolvabilité au Canada
Au carrefour de la fraude et de la bonne foi en matière d’insolvabilité au Canada
 |
Par Rachid Benmokrane, associé et Valerie Di Lena, avocate, Gowling WLG
En matière d’insolvabilité, l’obligation de bonne foi est essentielle et offre une garantie contre les comportements frauduleux là où la détresse financière peut altérer le jugement et le comportement. Ce principe fondamental veille à ce que toutes les parties, notamment les débiteurs, les créanciers et les syndics, séquestre ou contrôleur agissent de manière honnête et transparente tout au long du processus. Loin d’être un simple idéal éthique, la bonne foi est une obligation légale indispensable au respect de l’intégrité des procédures d’insolvabilité. Au Canada, cette obligation est inscrite dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») et dans la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »)1, ainsi que dans les principes de la common law et dans le Code civil du Québec.
La plupart des particuliers et des entreprises impliqués dans un processus d’insolvabilité sont honnêtes; il arrive néanmoins que certains exploitent le système et utilisent les procédures d’insolvabilité pour s’extirper de situations qu’ils ont créés du fait de leur mauvaise foi ou de leurs comportements frauduleux. En effet, nous avons observé dans la pratique une tendance croissante de cas de mauvaise foi ou de comportements frauduleux, notamment parmi les débiteurs. Ceci dit, les comportements frauduleux ne se limitent toutefois pas aux débiteurs; les créanciers et d’autres parties prenantes peuvent également exploiter les procédures en s’adonnant à des pratiques dolosive ou frauduleuses, par exemple en présentant des preuves de réclamation gonflées ou fausses, en étant de connivence avec un débiteur ou en fournissant des renseignements erronés au syndic, séquestre ou contrôleur. Bien que les parties ont le droit d’agir dans leur intérêt économique personnel, le fait d’induire délibérément les autres en erreur ou de manipuler la procédure à des fins personnelles constitue un acte de mauvaise foi, ce que de récentes décisions de la Cour d’appel du Québec étudiés ci-après ont réaffirmé.
Cet article traite également des recours et des mesures récemment prises par les tribunaux compétents en matière d’insolvabilité face aux cas de fraude et de mauvaise foi, au-delà des sanctions pénales prévues par la LFI et le Code criminel.
Tout d’abord, l’affaire 9298-9524 Québec inc. (Re)2 a réitéré l’importance de la bonne foi et de la diligence avant et pendant les procédures d’insolvabilité et de la divulgation franche et complète. Dans cette affaire, la Cour a rejeté la demande des débiteurs de prolonger de neuf mois une ordonnance initiale rendue en vertu de la LACC en raison, notamment, de la preuve de la mauvaise foi et de comportements frauduleux répétés des débiteurs à l’égard de leurs créanciers3. La Cour a mis en exergue de nombreuses décisions antérieures rendues à l’encontre de ces débiteurs et/ou de d’autres personnes impliquées : lesquelles révèlent des stratagèmes répétés en vue de frauder les droits de créanciers, notamment par le transfert d’actifs à des valeurs bien inférieures à celles du marché, l’utilisation de dettes garanties pour manipuler le processus et l’adoption de d’autres pratiques abusives de manière à éluder toute responsabilité financière.
Pour ajouter à l’absence de crédibilité, les débiteurs ont omis de divulguer des informations au cours de l’audience ex parte sur la demande d’émission d’une ordonnance initiale. Ce manque de transparence a non seulement affaibli leur position, mais a également mis en évidence leur absence de bonne foi, une exigence fondamentale requis dans des demandes en vertu de la LACC, en particulier lorsqu’ils sont entendus ex parte, où une norme plus élevée de divulgation et de transparence est attendue.
La Cour a finalement conclu que les débiteurs n’avaient pas rempli les critères nécessaires pour justifier la prorogation de l’ordonnance initiale, leurs actions étant notamment : (i) incompatibles avec les objectifs de la LACC, et (ii) leur comportement étant de mauvaise foi, suscitant de vives inquiétudes quant à la possibilité de causer un préjudice aux créanciers.
Cette décision permet de rappeler les objectifs de la LACC et que ceux qui recherchent sa protection doivent répondre à des normes élevées. Par ailleurs, cette décision rappelle un message important : la LACC est un mécanisme favorisant une restructuration et une équité en période de détresse financière et ne peut être utilisée à des fins d’abus ou de fraude.
Dans un autre arrêt récent de la Cour d’appel Poirier (Re)4, le failli-appelant (« Appellant » ou « Poirier ») a tenté de manipuler la procédure d’insolvabilité à des fins personnelles en faisant appel d’une ordonnance de faillite, afin, notammentde contrôler le choix du syndic.
Poirier a notamment fait valoir que la Cour supérieure avait perdu sa compétence pour rendre une ordonnance de faillite. Il a soutenu que l’ordonnance de faillite rendue par la Cour était sans objet, car il était déjà en faillite présumée, conformément à l’article 50.4(8) de la LFI, ayant omis de déposer certains documents dans le délai de 10 jours du dépôt de son avis d’intention de faire une proposition.
La Cour a constaté que (i) Poirier était un habitué de la cour et que des jugements antérieurs récents rendus contre lui et ses compagnies faisaient notamment état de stratagèmes auxquels il avait recours pour éluder sa responsabilité personnelle et pour frauder les droits de ses créanciers5; (ii) le dépôt d’un avis d’intention de faire une proposition n’enlève pas à la Cour sa compétence pour rendre une ordonnance de faillite. Il appartient à la cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour lever ou suspendre les procédures, même dans les cas de faillite présumée en vertu de l’article 50.4(8) de la LFI; (iii) le choix d’un syndic appartient ultimement aux créanciers (et non au débiteur), qui ont confirmé le syndic nommé par la cour lors d’une assemblée des créanciers; et (iv) Poirier n’a pas rempli son « obligation de bonne foi » en vertu de l’article 4.2(1) de la LFI.
Les actions de Poirier, notamment l’absence d’avis aux créanciers, le non-respect des exigences légales et la tentative de contrôler le choix du syndic, ont été jugées comme étant entachées par la mauvaise foi.
En conclusion, une partie ne peut espérer trouver une protection auprès de la Cour et s’attendre à ce que cette dernière cautionne sa conduite alors qu’elle poursuit un but illégitime. La Cour a également réaffirmé sa fonction de supervision pour prévenir toute utilisation abusive des procédures d’insolvabilité à des fins illégitimes, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’affaire
9354-9186 Québec Inc. c. Callidus Capital Corp6.
L’appel a finalement été rejeté avec dépens, soulignant que Poirier ne peut profiter de sa propre turpitude et que les tribunaux siégeant en matière de faillite ne toléreront pas toute tentative de porter atteinte à l’équité ou à la transparence dans les procédures d’insolvabilité.
À retenir
Les affaires citées précemment illustrent la façon dont la Cour procède lorsque le manque d’intégrité et de bonne foi entache les procédures d’insolvabilité. Ces arrêts renforcent également un principe essentiel : la bonne foi n’est pas négociable, et ceux qui ne respectent pas ce principe ne peuvent espérer obtenir une protection de la Cour.
Ceci dit, l’obligation de bonne foi dans un contexte d’insolvabilité ne signifie pas que toutes les décisions prises par un débiteur doivent aboutir à un résultat positif pour les créanciers. Il convient plutôt de s’attarder à l’intention réelle du débiteur de résoudre ses difficultés financières de manière transparente et équitable. À l’inverse, la mauvaise foi doit impliquer un certain comportement motivé par des objectifs illégitimes, comme les recours dilatoires ou la recherche d’avantages indus.
Les comportements frauduleux portent atteinte à l’intégrité du droit de l’insolvabilité et à la confiance des parties prenantes dans le système. L’application de l’obligation de bonne foi est donc essentielle pour maintenir la crédibilité des procédures d’insolvabilité, de façon à ce que toutes les parties prenantes puissent s’appuyer sur le système judiciaire afin d’obtenir des résultats équitables et libres de toute fraude ou de mauvaise foi.
Alors que le droit canadien de l’insolvabilité continue d’évoluer, l’application par les tribunaux de l’obligation de bonne foi restera sans aucun doute un principe fondamental, garant de l’équité, de la transparence et d’un processus équitable. Les comportements frauduleux ne sauraient être tolérés et les tribunaux ont démontré qu’ils agiront de manière décisive pour protéger l’intégrité du système là où peuvent s’immiscer la mauvaise foi et la fraude.
1 Depuis le 1er novembre 2019, les articles 4.2 de la LFI et 18.6 de la LACC prévoient que toute personne intéressée par l’une des procédures prévues par ces lois doit agir de bonne foi dans le cadre de cette procédure.
2 (Re) 9298-9524 Québec inc, 2023 QCCS 1111, permission d’appel refusée 2023 QCCA 612.
3 Ce n’est pas la première fois qu’une instance canadienne refuse de prolonger une ordonnance initiale en raison de l’absence de bonne foi et de diligence d’un débiteur. Dans l’affaire Envision Engineering & Contracting Inc, 2011 ONSC 631, une demande de prorogation a été rejetée en vertu de l’exigence de bonne foi énoncée au paragraphe 11.02(3) de la LACC.
4 Re Syndic de Poirier, 2024 QCCA 554
5 Dans l’affaire Ambroise c. Poirier, 2021 QCCS 2802, la juge Katheryne A. Desfossés a condamné in solidum 9298, Poirier et son partenaire d’affaire, un homme nommé Tony Palmorino. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel, qui a exposé le stratagème utilisé par Poirier et Palmorino visant à frauder les droits d’un créancier en créant une dette garantie par une hypothèque et en effectuant une prise en paiement.
6 9354-9186 Québec inc. c. Callidus Capital Corp. 2020 CSC 10.